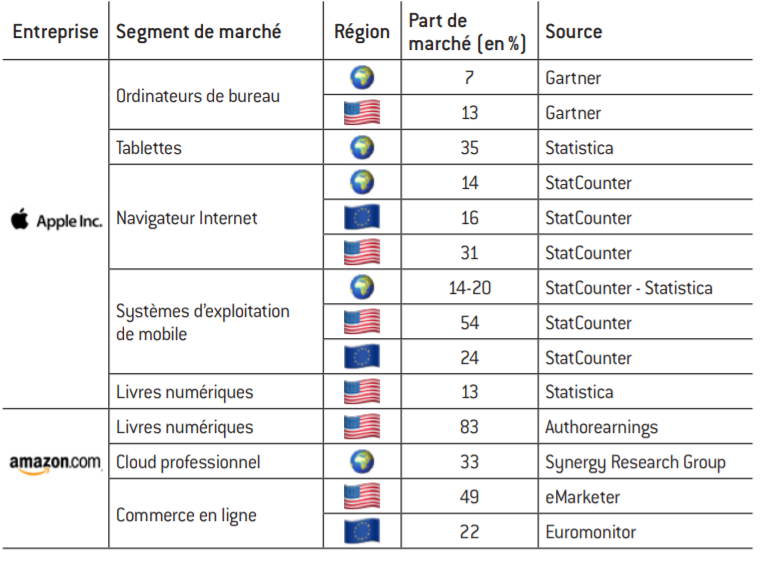Un couple kényen d’origine indienne a déposé une plainte contre une clinique de fertilité, soupçonnant les responsables d’avoir facilité un trafic humain après avoir constaté que l’enfant qu’ils avaient conçu via une mère porteuse présentait une pigmentation cutanée jugée inacceptable. Cette affaire a relancé le débat sur la gestation pour autrui (GPA) dans le pays, où cette pratique reste encadrée par des contrats privés sans réglementations légales claires.
Selon les informations révélées, l’enfant a été conçu en respectant un contrat standard de GPA : le sperme du père, l’ovule d’une donneuse issue de la communauté indienne et une mère porteuse sélectionnée par la clinique. Cependant, après l’accouchement, le couple a exprimé des réserves sur la couleur de la peau de l’enfant, estimant qu’elle ne correspondait pas à leurs attentes. « Ce contrat est crucial », a déclaré un avocat impliqué dans l’affaire, soulignant que les clients peuvent spécifier des critères ethniques pour garantir une ressemblance avec leur propre groupe.
Dans un pays où la GPA n’est pas encadrée par la loi, les contrats privés établissent les termes de ces accords. La mère porteuse renonce ensuite à ses droits parentaux, et le couple adopte l’enfant. Cette pratique, bien que controversée, reste une solution pour des familles confrontées à des difficultés d’infertilité. Cependant, cette affaire a mis en lumière les risques d’exploitation et de discriminations liés à ces accords non réglementés.